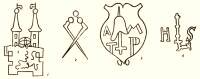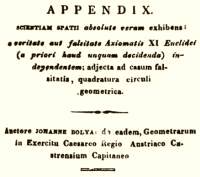| 1. Le nouveau système de domination | TABLE DES MATIÈRES | II – L’Ere des réformes nationales (1830-1848) |
2. Des Lumières au libéralisme
Table des matières
Lumières et cultures nationales
Au début des années 1770, on assiste à une véritable éclosion de la nouvelle pensée qui va servir de base à toute une nouvelle culture en Transylvanie. En effet, l’effervescence intellectuelle y est beaucoup plus marquée – et ceci, ni la première, ni la dernière fois dans l’histoire du pays – que ne le laisserait supposer son triste état socio-économique. Contradiction singulière certes, mais parfaitement compréhensible: on voit simultanément se développer un ensemble d’idées éclairées, supranationales, en même temps qu’un brusque épanouissement des cultures nationales qui vont préparer le terrain à l’avènement de la culture bourgeoise. Peut-on ranger d’un côté, ensemble, l’adepte de Christian Wolff, le traducteur de Montesquieu, le membre de la francmaçonnerie internationale, le haut fonctionnaire cultivé, partisan dévoué de l’absolutisme éclairé soi-disant supranational des Habsbourg et le savant chercheur, propagateur des sciences de la nature a priori internationales, pour mettre sur l’autre pôle tous les promoteurs des cultures nationales? Non, il n’y a pas de séparation de cette espèce: les représentants de la vie spirituelle transylvaine sont à la fois des deux bords, auxquels ils appartiennent chacun à sa manière et dans différentes mesures. Et rien n’est plus naturel que cela, si on observe les données ethniques de la Transylvanie et les caractéristiques de sa vie spirituelle «d’ancien régime».
Pour les Lumières, la principale force de cohésion fut la franc-maçonnerie. C’était vers 1742 que deux aristocrates hongrois et Samuel Bruckenthal, le futur grand homme d’Etat conservateur, eurent les premiers contacts avec ce mouvement intellectuel d’une grande efficacité organisationnelle. Mais leur zèle fut vite refroidi: Marie-Thérèse les plaça pour un moment sous surveillance domiciliaire à Vienne, en 1742. Néanmoins, la franc-maçonnerie ne tarda pas à prendre racine en Transylvanie, se limitant, il est vrai, pendant plusieurs dizaines d’années, aux Saxons. Fondée au milieu du siècle à Brassó, leur première loge nommée «Zu den 3 Säulen» connut une existence très brève. Plus persistante fut la loge St-André de Szeben «4 Heiliger Andreas zu den drei Seeblättern») fondée après 1764. Là aussi, le fondateur était un jeune patricien saxon, Simon Friedrich Baussnern, et ses membres des Saxons ayant fréquenté des milieux maçonniques pendant leurs études en Allemagne. Jusqu’en 1778, elle se compose presque uniquement de Saxons et de personnes originaires des pays héréditaires. A cette époque, un personnage singulier fait également partie de l’organisation: Alexandra Moruzi Mavrocordat, frère d’un prince de Moldavie. Le premier Hongrois à y entrer fut György Bánffy, le futur gouverneur. Dans les années 1780-1790, on y trouve déjà l’ensemble de l’élite intellectuelle et politique de la Transylvanie, qui comprend aussi bon nombre de Roumains. De nouvelles loges se créent et restent sous l’autorité de la loge provinciale ayant à sa tête György Bánffy comme Grand maître.
{f-417.} Les cadres de l’organisation maçonnique se modifient quand Joseph II, en 1785, fait fusionner les loges. Sa lettre patente n’autorise l’existence que d’une seule loge, à Szeben. En janvier 1796, même celle-ci est dissoute par François Ier: la franc-maçonnerie, qu’avaient ralliée, dans une période de stabilité, même les meilleurs esprits du gouvernement transylvain, devient suspecte aux yeux du pouvoir central raidi sous le choc de la Révolution française. On peut dire que, dans la Transylvanie des années 1770-1790, la franc-maçonnerie représentait une certaine force de cohésion et signifiait un engagement moral se fixant de travailler pour le bien public. Mais elle n’était pas une force politique, et encore moins un parti à caractère défini. Ni la nature du mouvement maçonnique, ni la situation politique ne le permettaient.
Bien qu’il ne soit pas directement lié aux Lumières, le progrès des sciences naturelles a tout de même nettement contribué à leur avancement. A partir des années 1750, ce progrès fait un bond spectaculaire en avant et met en relief des personnalités exceptionnelles. József Benkõ reprend en quelque sorte la succession de Péter Bod; mais il s’inspire déjà essentiellement des idées des Lumières. Son activité le place à cheval sur deux époques, ce qui se traduit dans les faits par l’acquisition d’une considérable renommée tant en sciences humaines qu’en sciences naturelles. Son ceuvre principale, Transylvania, est un travail historiographique qui frappe par la nouveauté de sa méthode: elle adopte celle de l’école des institutionnalistes en étendant ses investigations à la fois aux phénomènes matériels et spirituels de la vie sociale. Il met au point, suivant le système linnéen, un dictionnaire botanique en trois langues (latinhongrois-roumain) de la végétation de Transylvanie (Flora Transylvanica). On lui doit le premier traité de spéléologie, mais il écrit également à propos d’une plante utilisée dans l’industrie des cuirs (Le scumpia de Középajta), ainsi que du tabac. Il découvre les nouvelles possibilités de la vulgarisation scientifique. Une fraction de son ceuvre suffirait à lui assurer un professorat – la Société Savante de Haarlem, elle, l’élit parmi ses membres – mais la Transylvanie ne lui offre qu’un poste de pasteur de campagne, puis quelques années d’enseignement de la théologie à Udvarhely, d’où il est chassé par des intrigues misérables. Ce sont alors à nouveau les paroisses rurales, les humilitations, et tout au long de cette période de difficultés, l’alcool comme seul compagnon dans la solitude. Un sort que d’autres ont connu et connaîtront avant et après lui.
L’autre figure éminente de cette période, János Fridvalszky, eut une carrière aux traits moins dramatiques, mais le succès n’était pas, dans son cas non plus, proportionnel à la production. Diplômé de l’université de Vienne, il est nommé professeur de latin et de sciences naturelles à l’Ecole jésuite de Kolozsvár. A la différence de Benkõ, il est déjà entièrement tourné vers les sciences naturelles, et même vers sa branche expérimentale, qu’il met à profit dans ses inventions. La création d’une Societas Agriculturae, fondée pour promouvoir l’agriculture, eut un effet particulièrement fécond sur son esprit inventif. Il met au point des techniques pour la fabrication du pain ou de la bière avec de la pomme de terre, pour la distillation de l’eau de vie à partir du maïs et la production du papier avec du roseau, du jonc, du lin et du chanvre. Il extrait de la tourbe et fait la démonstration de sa combustibilité devant la Société. On lui doit même un vaste projet de réforme économique. Mais ses innombrables propositions et inventions utiles n’auront connu pratiquement aucune application concrète. Ni la demande ni les conditions sociales ne s’y prêtaient.
La troisième grande personnalité de la science transylvaine, József Fogarasi Pap, connaît un début de carrière brillant. Son travail, qui donne l’interprétation {f-418.} de la notion de «force» dans son acception la plus large, remporte en 1778 le concours de l’Académie des Sciences de Berlin. L’śuvre témoigne de l’influence de Leibniz et de l’idéalisme (la cause première de la force est en dehors de l’homme: c’est Dieu; la force de l’imagination fait partie des forces réelles). Dans le même temps, il ne reste pas en arrière, sur bien des points, par rapport aux derniers résultats des sciences naturelles de son époque. La mort le ravit au moment même où il allait occuper son poste à la tête d’une chaire universitaire à Pest.
Les collèges réformés et les lycées saxons bien équipés assument également une fonction de propagateurs des nouvelles sciences de la nature. A Nagyenyed, la physique est enseignée, après 1767, par József Kovács qui traduit la physique newtonienne de Krueger, et la publie en 1774. A la même époque, on trouve ici comme professeur le géologue-botaniste-minéralogiste Ferenc Benkõ, qui est élu membre de la Société Scientifique d’Iéna.
A l’Académie de Kolozsvár, qui est passée, après la dissolution de l’ordre des jésuites, aux mains des piaristes, deux éminents savants, dans les années 1780, mènent une importante activité; l’un, André Etienne, est professeur de chimie et de métallurgie et propagateur du système de Lavoisier; l’autre est l’ophtalmologiste Ion Piuariu-Molnár, dont on parlera plus tard. Des médecins praticiens exécutent des ouvrages spécialisés de thérapeutique qui dressent un tableau des conditions hygiéniques de l’époque.
Franc-maçonnerie, sciences naturelles, voilà les pôles d’attraction intellectuels, internationaux, qui étaient censés orienter les différentes collectivités dans la même direction. Lumières et éveil national vont de concert en Transylvanie. Et, au début, cet éveil ne revêt pas encore un caractère véritablement politique. Au moment où la pénétration des Lumières en Transylvanie se fait plus intensive, les chances d’une activité politique y sont justement plus restreintes: à partir de 1761, pendant 29 ans, la Diète ne siège plus et on n’y trouve pas non plus d’autres foyers d’activités politiques de portée nationale. Durant des décennies, l’éveil national se cantonne dans des efforts visant le développement de la culture nationale.
Ce sont les Saxons qui se trouvent momentanément dans la situation la plus favorable. Leur jeunesse continue de fréquenter les universités allemandes. Ainsi, en 1774, on trouve à Goettingen, entre autres, Michael Hiszmann, Martin Lang, Karl Bruckenthal, Johann Filtsch. La Königliche Deutsche Gesellschaft de Goettingen maintient des contacts avec l’élite intellectuelle des Saxons de Transylvanie. En 1799, Filtsch, Eder et A. Wolff sont élus membres correspondants de la Société. Hiszmann, après ses études, s’installe à Goettingen et devient le traducteur de bon nombre d’śuvres philosophiques anglaises et françaises. Il est lui-même un écrivain éclairé qui, dans ses ouvrages, propose une critique acerbe de la métaphysique et étudie les problèmes de la psychologie humaine. Il manifeste à plusieurs reprises ses réserves à l’égard de Leibniz et se permet des remarques un peu trop acides contre Wolff. Dans la dispute qui oppose Lessing à Goethe, il prend position en faveur du premier. Son activité philosophique lui barre le chemin du retour en Transylvanie: l’évêque luthérien Andreas Funk interdit la propagation des «lettres philosophiques» de Hiszmann et quand il s’avise de rentrer, ses amis l’en dissuadent.
Un moyen encore plus efficace pour maintenir le contact avec la vie spirituelle allemande est constitué par le théâtre. Et, conjointement avec celui-ci, apparaissent, chez les Saxons, les premiers éléments d’une vie littéraire moderne: en 1775, paraît à Szeben le Theatralisches Wochenblatt, revue de théâtre {f-419.} qui, au-delà des nouvelles de la vie théâtrale, rend également compte des événements littéraires de l’époque, surtout de ceux des territoires germanophones.
Dans la culture propre des Saxons, une place de choix revient à l’historiographie qui favorise l’épanouissement de personnalités comme Johann Seivert, auteur d’une série d’articles parus dans Ungarisches Magazin de Pozsony sur les carrières des dignitaires laïcs et ecclésiastiques saxons, et aussi d’une śuvre majeure d’histoire culturelle: Nachrichten von siebenbürgischen Gelehrten und ihren Schriften. Ou bien, on peut citer le nom de J. C. Eder qui, dans les années 1790, rassemble autour de lui tout un groupement d’amateurs d’histoire.
Un fait qui témoigne du renforcement de la culture saxonne est l’organisation de l’accès aux livres. La collection Bruckenthal est en même temps une bibliothèque publique; en 1782, on ouvre à Szeben la première bibliothèque de prêt; deux ans plus tard s’y constitue une société des lecteurs qui servira de modèle à d’autres tentatives analogues. Parallèlement aux Lumières, pénètre auprès des Saxons la presse régulière. Et c’est précisément là que se trouve le point faible de la vie intellectuelle, qui s’appuie pourtant sur une couche relativement large d’esprits cultivés ou voulant se cultiver: grâce à la presse et à une communication facilitée par la langue, elle accède rapidement aux meilleurs produits de la culture allemande, qui prend à cette époque un essor fascinant. Pourtant, cela ne stimule point cette culture dans la création, du moins en art, mais exerce sur elle un effet plutôt décourageant; aussi, cette époque ne verra-t-elle pas l’envol des belles-lettres saxonnes.
Tout autres étaient les motivations et les difficultés des Hongrois transylvains cultivés voulant s’adonner à la création littéraire. Le demi-siècle précédent a vu surgir un seul grand talent littéraire: Kelemen Mikes, dont les lettres fictives, rédigées durant son exil en Turquie (à Rodosto-Tekirdaģ), devaient rester inconnues jusqu’en 1794, pour devenir ensuite la lecture de beaucoup et inspiratrices du patriotisme hongrois pour bien longtemps. Les auteurs qui le suivent sont presque sans exception eux aussi des mémorialistes ou tiennent des journaux intimes. La littérature de mémoires, qui avait autrefois donné naissance, en Transylvanie, à des śuvres d’une grande qualité, n’est plus capable, à cette époque, que d’un «chant chu cygne a. C’est l’écrit autobiographique de Kata Bethlen, une veuve issue de la haute noblesse qui réagit à l’attaque de la Contre-Réforme par un calvinisme outré et fait construire un moulin à papier destiné à des publications religieuses patronnées par elle. Elle prend Péter Bod sous sa protection; son śuvre ne sera vraiment découverte que deux cents ans plus tard, par la critique littéraire recherchant ses racines.
Un paradoxe de l’histoire mais qui n’est pourtant pas fortuit: au XVIIIe siècle, la littérature hongroise de Transylvanie s’affirme d’abord à Rodosto, ensuite à Vienne. C’est en effet dans la capitale impériale que les officiers cultivés de la garde royale frayent la voie à la littérature des Lumières. Marie-Thérèse y a créé une garde des nobles hongrois censée servir d’ornement baroque à son règne absolutiste. Cette garde comprenait également de jeunes Transylvains. Il en est né un groupe qui sera, pour un certain temps, le principal centre de rayonnement de la culture hongroise. A côté de son chef de file, le noble calviniste du Partium György Bessenyei, le second rôle revient à un Transylvain, le colonel Ábrahám Barcsay. Personne, dans la poésie hongroise, ne chantera avec autant d’enthousiasme que lui les bienfaits de la paix qu’il juge indispensable à la liberté de l’homme.
Cette effervescence de la littérature hongroise ne suffit pas encore à faire {f-420.} naître en Transylvanie une presse de langue hongroise. La contribution transylvaine est cependant considérable aux gazettes paraissant en Hongrie ou à Vienne. Ainsi, les efforts littéraires progressivement déployés par les Hongrois de Transylvanie, s’intègrent organiquement à la vie spirituelle hongroise, grâce notamment à des attaches personnelles, et malgré l’éloignement géographique de leurs promoteurs.
Des trois ethnies transylvaines, c’étaient sans doute les Roumains qui se trouvaient dans la situation la moins favorable au moment de la pénétration des idées éclairées. D’autant plus respectable fut leur apport dans le domaine culturel. Les ambitions intellectuelles roumaines ne pouvaient pas encore éclore dans les belles-lettres, car la tâche essentielle du moment était de former la conscience nationale en ressuscitant le mouvement enlisé depuis l’évincement de Inochentie Micu-Klein. La célèbre triade: Samuil Micu-Klein, Gheorghe Şincai et Petru Maior, figures les plus importantes de la culture roumaine de Transylvanie au XVIIIe siècle, firent un immense travail précisément dans ce sens. Tous furent des polygraphes formés en Transylvanie, à Rome ou à Vienne, qui obtenaient des résultats sérieux dans des domaines allant, conformément aux idéaux encyclopédiques du XVIIIe siècle, de la recherche approfondie à la vulgarisation scientifique. Au cśur de leur idéologie nationale, se trouvait l’origine romaine, une conception fondamentale enrichie de l’idée que les Roumains vivant au-delà et en-deçà des Carpates ne formaient qu’un seul peuple. Restant fidèles à l’Eglise uniate, ces hommes de lettres ne partageaient cependant pas l’hostilité de la génération précédente à l’égard de l’Eglise orthodoxe; au contraire, ils étaient fort érudits en matière de droit canon orthodoxe. Leurs écrits alliaient avec bonheur l’esprit gallican, la politique religieuse joséphiste et le traditionalisme orthodoxe.
L’absolutisme éclairé leur ouvrait des horizons qui, par exemple, firent naître en Samuil Micu-Klein l’espoir de réunir éventuellement les territoires habités par les Roumains, en les dotant d’un uniatisme respectueux des traditions orthodoxes, ceci sous le règne des Habsbourg et en vertu de leur titre de roi de Hongrie. Il publia, en 1780, à Vienne, son Elementa linguae Daco-Romance sine Valachicae, principalement destiné à convaincre l’opinion non roumaine du caractère latin de la langue roumaine. Même s’il écrivait généralement ses ouvrages en alphabet cyrillique, ce fut pourtant lui qui publia, en 1779, le premier livre en caractères latins (et avec une orthographe non hongroise), un livre de prières. Il traduisit aussi la Bible qui parut en 1779. Ses synthèses historiques sont restées à l’état de manuscrit, quelquesunes jusqu’à nos jours.
Le second membre de la triade, Gheorghe Şincai fut l’organisateur, en tant qu’inspecteur de l’instruction populaire, d’un bon nombre d’écoles rurales dans le cadre du programme d’éducation de l’absolutisme éclairé. Il rédigea un abécédaire, à l’intention de l’école de Balázsfalva, en langues latine, hongroise, allemande et roumaine, puis, en roumain seulement, des manuels d’alphabétisation, d’initiation à l’arithmétique, de latin et de catéchisme. Il écrivit, presque toute sa vie durant, une grande synthèse historique: Hronica Românilor. Parmi ses sources, on relève l’ensemble des littératures est-européennes, mais en premier lieu des ouvrages hongrois. Il puise en effet largement dans les archives transylvaines, dans les matériaux des Diètes, dans les documents déjà rassemblés par les savants hongrois. Il est également rattaché à la culture hongroise de l’époque par des liens personnels: à Vienne il fait la connaissance de József Benkõ et de Dániel Cornides et il compte l’historien et archiviste Márton György Kovachich parmi ses amis. A plusieurs reprises au cours de {f-421.} sa vie mouvementée, il profite de l’appui de la famille aristocratique Wass c’est dans leur propriété même qu’il sera enseveli. Quant au troisième membre de la triade, Petru Maior, il réalisera l’essentiel de son activité dans la période suivante.
Figure éminente de l’intelligentsia roumaine orthodoxe de Transylvanie, l’instituteur de Brassó Dimitrie Eustatievici écrit en 1757, après ses études à Kiev, une grammaire roumaine. Mais son parti pris pour le roumain ne signifie pas pour autant un refus du slavon comme langue liturgique de la religion orthodoxe. Par ses vues politiques, il se range aux côtés de ceux qui veulent obtenir, pour les Roumains, des droits nationaux a illyriens a. D’abord secrétaire épiscopal, il devient, sous Joseph II, inspecteur des écoles orthodoxes de Transylvanie et c’est en cette qualité qu’il organise des cours accélérés de six semaines permettant de former 10-12 instituteurs et ce, afin de rémédier au manque cuisant d’enseignants.
Le sort des écoles roumaines orthodoxes préoccupe également Ioan Piuariu-Molnár, l’un des personnages roumains les plus marquants de l’époque, qui travaillait aussi comme professeur d’ophtalmologie à Kolozsvár. En tant qu’auteur de livres de vulgarisation – consacrés aux accouchements et à l’apiculture –, il s’assura une plus grande audience que tous les autres, pour la simple raison que la langue de ses écrits était plus intelligible à ses lecteurs. C’est par ailleurs à lui qu’on devait à l’époque la meilleure grammaire du roumain.
L’expansion de la culture roumaine allait de pair avec l’apparition des intellectuels roumains sur la scène politique. Il faut dire en effet que, sous Joseph II, tant le Gubernium que la Chancellerie Aulique de Transylvanie comptaient des Roumains parmi leurs fonctionnaires. Vers la fin du règne de Joseph II, István Koszta est déjà conseiller du Gubernium et il est ensuite promu au poste de «cancellarius provinciales», c’est-à-dire d’officier suprême surveillant l’activité administrative du Gubernium. C’est un haut fonctionnaire extrêmement laborieux et précis qui a laissé derrière lui, dans ses dossiers officiels, des milliers de pages couvertes d’une fine écriture. Pendant le lent recul du joséphisme, c’est à lui qu’on confie les tâches les plus épineuses, sinon dangereuses. Dans l’administration des comitats, par contre, on ne trouvait qu’exceptionnellement des fonctionnaires roumains, étant donné la proportion modeste de la noblesse foncière roumaine.
Les premières décennies de l’absolutisme éclairé
Dans les années 1770-71, l’absolutisme éclairé commença également à se manifester dans l’administration de la Transylvanie.
Ce fut dans le domaine de l’économie que l’intervention du gouvernement Habsbourg fut la moins heureuse. En effet, les conceptions économiques de ses différentes commissions étaient bonnes à tout sauf à réduire la différence de niveau entre la Transylvanie et les provinces occidentales, beaucoup plus industrialisées, de l’Empire Habsbourg; elles tendaient même à l’accroître, en déconseillant l’établissement de nouvelles manufactures et en limitant l’industrie à la fabrication des articles d’usage les plus courants. S’il surgit pourtant quelques manufactures en Transylvanie, ce fut en dépit de cette politique, bien que parfois sur l’initiative même des organes d’administration (moulin à papier à Orlát; fonderie de l’acier et des métaux précieux).
Les dix premières années d’abolutisme éclairé ne virent pas non plus de progrès en matière de réglementation des redevances féodales. Le gouvernement {f-422.} ne pouvait – et en partie ne voulait – obtenir autre chose que le maintien du statu quo. Craignant de voir s’intensifier la uite des Transylvains vers la Moldavie où les serfs auraient été, selon la rumeur, exemptés des charges serviles à la veille de la guerre turco-russe, Marie-Thérèse ordonna, en juin 1770, d’établir un plan destiné à réglementer les redevances en Transylvanie à la lumière des expériences de la réglementation en vigueur en Hongrie. Mais le projet s’enlisa dans l’inertie de la bureaucratie.
Un progrès plus notable put être enregistré en matière de politique religieuse et d’enseignement. L’absolutisme éclairé entend renforcer son contrôle sur l’Eglise catholique et supprimer, ou du moins diminuer, le rôle de ses dignitaires dans la hiérarchie séculière. Ainsi, l’évêque catholique ne préside plus aux conseils du Gubernium. Le pouvoir d’Etat intervient énergiquement dans la vie de l’Eglise: il se prononce dans des questions organisationnelles et économiques internes à l’Eglise et contrôle l’ensemble de l’enseignement. En 1781 fut publié la Norma Regia qui stipulait que le Gubernium (c’est-à-dire sa Commissio Litteraria, récemment créée) devait assurer la direction nationale de l’instruction publique. Le système éducatif uni fut appliqué aux écoles de toutes confessions et on déclara la scolarité obligatoire à partir de six ans. Les études secondaires, par contre, ne s’ouvraient qu’à ceux qui en avaient non seulement l’aptitude, mais aussi les moyens financiers.
La seconde décennie de l’absolutisme éclairé est en général rattachée à la personne de Joseph II qui monta sur le trône en 1780. C’était un personnage dont l’activité fut analysée, d’abord par ses contemporains, puis par l’historiographie, sous des éclairages diamétralement opposés. La conception indépendantiste hongroise regarde la politique de l’Empereur et de son gouvernement dans son ensemble comme une atteinte à l’autonomie et aux intérêts de la nation hongroise. A l’autre extrémité, on voit le portrait d’un souverain réformateur aux traits presque révolutionnaires, qui entend introduire dans son empire un système nouveau, perfectionné sous tous ses aspects, mais dont les efforts sont constamment mis en échec par les forces rétrogrades. A partir de ces deux «versions», il s’est créé, en fonction des différentes motivations nationales, une grande variété d’interprétations et non seulement du point de vue hongrois. Aux représentants des ambitions nationales roumaines, par exemple, l’absolutisme éclairé a ouvert des perspectives jusqu’alors insoupçonnées, tandis que le statut juridique de la «nation» saxonne n’avait jamais été aussi gravement menacé que par ce régime d’une implacable rationalité. Il est incontestable que tous les efforts du joséphisme visaient la plus grande stabilité de l’Empire; d’autre part, on ne doit pas oublier non plus que Joseph II publia, dès la première année de son règne, un édit de tolérance religieuse également valable pour la Transylvanie, qui constituait un pas important vers la conception moderne de la liberté confessionnelle.
La politique économique joséphiste se définit par deux visées: faire régner le principe de la concurrence en supprimant le système des privilèges artisanaux à l’intérieur du pays et maintenir un système douanier protectionniste vers l’extérieur. L’objectif de Joseph II était d’assurer l’unité économique de l’Empire et de la fonder sur l’autarcie. Il supprime les barrières douanières entre la Hongrie et la Transylvanie, ce qui signifie l’union économique des deux moitiés du pays, leur unification administrative étant déjà réalisée. On maintient toutefois une politique douanière qui donnait l’avantage aux pays héréditaires d’Autriche et de Bohême et dont les efforts visant l’autarcie n’étaient pas non plus favorables à la disparition des différences de degré de développement.
{f-423.} Bien que le joséphisme n’adoptât pas de politique d’industrialisation générale pour la Transylvanie, il ne laissa pas non plus libre cours à une pratique discriminatoire. Il suffit de citer l’établissement de l’usine de soierie de Gallarati, encouragé par le gouvernement, ou l’essor de la métallurgie du fer dans la région de Vajdahunyad. Les produits industriels de Transylvanie jouissaient parfois d’un traitement douanier préférentiel, même face à ceux des pays héréditaires, en vertu du fait que, comme le soulignait Joseph II, la Transylvanie était plus fortement imposée que la Hongrie.
Les démarches en matière de politique servile étaient nettement positives. Rien ne peut mieux refléter la nature du joséphisme sous sa variante transylvaine que le résultat de ces démarches, c’est-à-dire les mesures qui s’en suivirent, leur degré de réalisation, leurs conséquences. Lors d’une de ses visites en Transylvanie, en 1783, Joseph II ordonne au vice-chancelier de Hongrie-Transylvanie, Károly József Pálffy, de rédiger incessamment une proclamation sur la suppression du servage perpétuel. La résistance de la Chancellerie fit échouer le plan, mais le décret du souverain, daté du 16 juillet 1783, assurait aux serfs le droit de se marier sans la permission de leur seigneur, ainsi que d’apprendre et d’exercer des métiers industriels ou intellectuels, de disposer librement de leur propriété légale, de ne pas être chassés de leur tenure sans arrêt juridique, ni transférés d’un comitat à l’autre, enfin de ne pas être contraints à des corvées autres que celles précisées dans la réglementation provisoire. Mais, avant que puissent se réaliser la réglementation des redevances et la suppression du servage perpétuel, éclata, en 1784, l’une des plus grandes révoltes paysannes transylvaines de l’époque féodale.
La révolte de Horea et de Cloşca
Les causes des événements de l’automne 1784 furent multiples. Tout d’abord, cette période connut une recrudescence de la tension entre seigneurs et serfs dans l’ensemble de la Transylvanie, mais dans les Monts métalliques, pour des raisons locales, la situation se dégrada avec une rapidité toute particulière. Vu le caractère montagneux et fort boisé des domaines du Trésor à Zalatna, les villages qui s’y trouvaient éparpillés dans les immenses forêts purent longtemps dissimuler une grande partie de leur population aux percepteurs de l’impôt. Mais après un examen minutieux en 1772, on redouble les charges fiscales de ces communes domaniales et, qui plus est, leur corvée aussi s’alourdit considérablement: on introduit le service de deux journées hebdomadaires, en même temps que l’obligation de travailler pour un salaire infime, mesures auxquelles s’ajoutent la suppression de certains avantages. Si bien que la recette que le Trésor réalise sur les 7 000-7 500 censiers du domaine de Zalatna est désormais triplée par rapport à l’époque antérieure. Les serfs adressent leurs griefs directement au souverain. Dans la députation, envoyée en 1779, nous voyons déjà les futurs chefs de la révolte: Horea et Cloşca.
Né en 1730, Horea (de son vrai nom: Vasile Nicula) fut un serf fugitif qui s’était racheté, puis en tant que charpentier avait parcouru la majeure partie de la Transylvanie, en faisant une fortune considérable pour un paysan. Homme expérimenté, il est désigné pour le voyage à Vienne, où il retournera plusieurs fois par la suite.
En mai 1782, une émeute éclate à la foire de Topánfalva, à l’issue d’une dispute au sujet de la licence de débit des domaines de Zalatna. Agacé par le fait d’être exclu de cette licence, le peuple enfonce les tonneaux des deux {f-424.} Arméniens qui jouissent du monopole. Le tribunal seigneurial de Zalatna opte pour la répression et prononce contre les coupables de lourds verdicts, jusqu’à la peine capitale, tandis que les deux preneurs à bail exigent des dommages et intérêts. Ayant participé à l’émeute, Horea doit reprendre le chemin de Vienne pour exposer les plaintes des habitants du domaine. Il parvient devant l’Empereur en personne, chose non exceptionnelle, car Joseph II avait l’habitude de recevoir personnellement les requêtes serviles en émettant quelques mots d’encouragement. Et, en avril 1784, Horea entend confirmer par la Chancellerie elle-même que le Gubernium a reçu la consigne de protéger les communes du domaine de Zalatna contre les officiers du comitat et du domaine jusqu’à ce que l’Empereur statue sur l’affaire. Horea et ses compagnons, après avoir vainement sollicité la protection du Gubernium et du comitat, s’adressent au commandement militaire de Gyulafehérvár.
A cette époque-là justement, Joseph II ordonne, afin d’augmenter les effectifs de la garde-frontières, de recruter des volontaires dans les villages de la zone frontalière. En 1784, les paysans, qui se sont rassemblés à la foire de Gyulafehérvár, se font engager, à la suite d’une interprétation erronée de la volonté impériale, en très grand nombre: à la mi-août, les habitants de 80 villages sont déjà prêts à prendre les armes. Une partie des conscrits refuse la corvée, d’autres exercent des violences contre ceux qui ne veulent pas s’enrôler. C’est là une situation analogue à celle qui s’était produite en 1762-63, lors du recrutement des Sicules pour la garde-frontières. Mais le Gubernium ordonne de mettre fin aux conscriptions entreprises à son insu et invalide des enrôlements.
C’est à ce moment-là que Horea et ses compagnons cherchent à entrer en contact avec le commandement de Gyulafehérvár et, suite à une seconde interprétation erronée, la rumeur commence à se répandre que Horea aurait reçu l’ordre de l’Empereur de prendre les armes. Les voilà aussitôt au seuil de la révolte armée. Un serf qui s’est enfui du domaine de Zalatna, Gheorghe Crişan, convoque, pour le 3 t octobre 1784, les paysans de la vallée du Fehér-Körös à se réunir à Mesztákon, d’où ils se rendent à Gyulafehérvár pour demander leur admission dans la garde-frontières. Sur leur chemin, ils rencontrent des officiers et des haïdouks du comitat qui tentent de les disperser, et des affrontements violents s’ensuivent. Le soulèvement est commencé et sera rejoint en quelques jours par la population paysanne de la région du Sud-Ouest de la Transylvanie. Dans le comitat de Zaránd, les émeutiers pillent plusieurs dizaines de domaines nobiliaires et le feu de la révolte embrase également les territoires attenants de Hongrie. Le soulèvement se généralise dans le comitat de Hunyad. La population paysanne, avec Horea, Cloşca et Crişan à sa tête, assaille Abrudbánya et Verespatak; ils mettent à mort, à plus d’un endroits, les officiers du comitat ou du Trésor, les prêtres non roumains, parfois même des maires de village.
Du côté du gouvernement, les mesures se font attendre. Le gouverneur Samuel Bruckenthal demande l’intervention des forces militaires contre la sédition, mais le haut commandement, n’ayant pas reçu d’instruction de Vienne, hésite. Le soulèvement ne cesse de prendre de l’ampleur. Le Gubernium et le commandement militaire entament séparément des négociations avec les insurgés. Entre-temps, la noblesse s’organise, en plusieurs endroits de la région, pour se protéger; près de Déva, elle défait les paysans révoltés grâce à l’aide des hussards de la garnison locale et, après des jugements sommaires, fait exécuter 56 personnes. D’autres confrontations ont également lieu entre nobles et paysans soulevés et parfois c’est l’armée – le plus souvent des {f-425.} hussards hongrois ou sicules – qui entreprend de son propre chef des opérations contre les paysans.
Pour Joseph II et son gouvernement, il est difficile d’adopter une position cohérente face à la révolte, d’autant que les nouvelles n’en parviennent à Vienne qu’avec un grand retard et qu’elles sont, qui plus est, fort contradictoires. Au sein du gouvernement central, on discute des principes; d’abord c’est la sécurité d’Etat qui prévaut: informé de la révolte le 12 novembre 1784, Joseph II envoie aussitôt au commandement militaire l’ordre de la briser par la force. Mais on est bientôt gagné par les considérations d’une politique favorable aux serfs. Vers le 17 novembre, un circulaire du Gubernium éveille le soupçon de l’Empereur: les abus des fonctionnaires de comitat ont dû contribuer à la révolte. Le 19 novembre, il est déjà d’avis que la responsabilité est du côté des seigneurs qui exercent sur leurs serfs les oppressions les plus diverses. Il envoie sur les lieux un commissaire enquêteur, Antal Jankovics, un adepte dévoué de la politique joséphiste.
L’Empereur traverse une lourde crise de conscience. Quand il apprend la nouvelle des exécutions sommaires de Déva, il trouve naturelle une pareille réaction de la part des nobles. Joseph II considère la révolte comme un signe de l’échec de sa politique. Il recule cependant devant l’idée d’une répression sanglante qu’il tient aussi pour déraisonnable, le feu pouvant s’attiser de nouveau, à la première occasion venue. Des mesures sont alors prises pour arrêter les tribunaux d’exception et la mobilisation générale des nobles qu’on suppose être déclenchée. Pour apporter une solution politique, il faudrait, dans sa conception, commencer par abolir le servage perpétuel.
Mais le point de vue de la sécurité d’Etat, les arguments des militaires reprendront bientôt le dessus. Le 13 décembre 1784, l’Empereur se met à envoyer des instructions: la révolte ne saurait être écrasée sans l’usage de la violence sanglante; il était erroné de ne pas la prendre dès le début au sérieux l’armée doit en venir à bout avec fermeté. Mais le soulèvement est déjà essouflé. Le commandement envoie dans les Monts métalliques deux colonnes de 750 à 800 soldats qui dispersent les révoltés. Horea et Cloşca sont capturés, à la fin de décembre, avec l’aide des paysans.
Les représailles devaient se dérouler selon les instructions directes de Joseph II. Il fallait faire un exemple par le châtiment des chefs de file. On les promena aux endroits où ils avaient «perpétré leurs plus odieux forfaits», pour les exécuter ensuite publiquement pour l’édification des paysans rassemblés.
En fait plus de 660 personnes furent traduites devant la commission, 300 d’entre elles, qui avaient rallié les révoltés sous la contrainte et n’avaient rien commis de grave, furent libérées. Les serfs qui s’y étaient ralliés volontairement et avaient participé aux pillages (environ 180 personnes) furent également libérés après une bastonnade. Parmi les 120 condamnés pour un crime capital, on prononça la peine de mort contre 37; le reste fut envoyé en prison. Les condamnés à mort furent grâciés par Joseph II, à l’exception des trois chefs, parmi lesquels Crişan se suicida dans sa prison, tandis que Horea et Cloşca furent rompus vifs à la route le 18 février 1785, à Gyulafehérvár, en présence des foules de paysans convoquées pour l’occasion.
Peut-on dire que cette révolte avait le caractère d’un massacre dirigé contre les membres d’un groupe ethnique précis, comme le supposait Joseph II? En fait, les territoires où éclata le mouvement étaient habités par des serfs presque exclusivement roumains, tandis que la noblesse terrienne et les fonctionnaires du comitat étaient tous des Hongrois, indépendamment des origines ethniques de leur famille. Le caractère «national» est apparamment attesté également par {f-426.} le fait que les soulevés firent adopter la religion orthodoxe à des nobles capturés et contraignirent des demoiselles nobles hongroises au mariage avec de jeunes Roumains. Mais les motifs étaient moins nationaux ou ethniques que religieux; c’était également l’expression d’un égalitarisme paysan. Les dernières recherches ont prouvé que des Hongrois et aussi des Saxons prirent part aux événements: ils s’enrôlèrent dans la garde-frontières et soutinrent la révolte des Hongrois de Abrudbánya (par exemple des mineurs, parfois même des dirigeants), et des villages saxons de la région de Kisenyed ainsi que la localité majoritairement hongroise de Torockószentgyörgy rallièrent également le mouvement. Dans les comitats de Torda et de Kolozs, on condamna plusieurs serfs hongrois pour participation à la révolte. D’un autre côté, les intellectuels roumains, promoteurs de la conscience nationale, ne s’y rallièrent pas. Samuil Micu-Klein qualifia Horea et ses compagnons de «gens maudits qui veulent perdre la noblesse».
Les réformes joséphistes
Le soulèvement, aussi bien que la logique de ses propres réformes, affermissent Joseph II dans sa conviction que le problème des serfs demande une solution politique urgente. Dans son décret du 2 août 1785 (reprenant le contenu de celui du 16 juillet 1783), il abolit l’attachement des serfs à la glèbe. Cependant, le but primordial, réglementer les redevances et services censiers, devait une fois de plus échouer. En 1785, pourtant, on entame les travaux préparatoires: adoptant la méthode utilisée en Hongrie, on tente de dresser un relevé des tenures serviles, des droits y afférents et des prestations dues. Mais, même pour établir la taille d’une unité censière, on ne parvient pas à se mettre d’accord. Joseph II suspend l’affaire pour ne plus jamais y revenir. Afin d’alléger un tant soit peu la situation des paysans, il tente de réglementer certains détails des obligations serviles sans grand succès, d’une part parce que les seigneurs terriens protestèrent contre l’intervention de l’Etat dans les formes de travail qu’ils exigeaient de leurs serfs, d’autre part parce que les règles de gestion prescrites par le souverain étaient fort éloignées de la réalité transylvaine (d’après les dispositions de 1787, non seulement le seigneur terrien ou ses employés devaient tenir des registres sur la corvée fournie par le serf, mais ce dernier aussi devait conserver un livre où son maître justifiait ses journées accomplies).
Le joséphisme tenta de rationaliser les principes de gouvernement ainsi que ceux de l’administration à des échelles inférieures. Joseph II réunifia, en plusieurs étapes, les Chancelleries Auliques de Hongrie et de Transylvanie et alla même jusqu’à proposer, en alléguant l’appartenance de la Transylvanie à la Couronne de Hongrie, le rétablissement de la dignité de voïvode, telle qu’elle avait été en vigueur avant la première amputation («vor der ersten Trennung» de la province.
Plus difficile était la réforme, pourtant d’une ultime urgence, de l’administration fondée sur la représentation nobiliaire, surtout dans sa division territoriale. Les comitats, qui traversaient le pays de l’est à l’ouest en bandes, larges parfois de 2 à 3 villages seulement, ou bien le comitat de Felsõ-Fehér, découpé, par suite de la création des sièges saxons, en une multitude de petites unités, ou encore les sièges sicules et saxons plus petits qu’un district d’une autre région, tout cela demandait à être transformé. Mais mille obstacles s’y {f-427.} opposaient: d’une part les intérêts de la noblesse locale (ou, chez les Saxons, ceux des patriciens notables); ensuite le fait que l’autorité représentative était détenue par les trois «nations» ayant des droits «nationaux» et municipaux différents, alors qu’une réforme territoriale un peu plus sérieuse aurait dû passer outre leurs découpages actuels.
Quoi qu’il en soit, le gouvernement central relève le défi et entame la réforme. Le premier coup est porté, en 1781, contre les privilèges des Saxons: on reconnaît l’égalité des droits, c’est-à-dire la «concivilitas» des Roumains de Königsboden. Deuxième étape: en 1782, Joseph II fait réquisitionner les biens de la «nation» saxonne au profit du Trésor, en alléguant que celui-ci est propriétaire de l’ensemble de Königsboden.
En 1784, le territoire transylvain est redivisé en 11 comitats, système qui fait abstraction de l’organisation des «nations» reconnues et de leur autonomie municipale. En janvier 1786, on organise trois commissions de circonscription qui répartissent entre elles les comitats et siègent à Szeben, Fogaras et Kolozsvár avec, à leur tête, des commissaires. Ainsi se crée finalement l’organe exécutif direct du pouvoir absolutiste. Mais cette décision reste lettre morte, puisque l’appareil devient, précisément à ce moment, inopérant.
On ne parvient pas non plus à séparer la juridiction et l’administration. Une conception éclairée et une sévérité draconienne, voilà les deux composantes qui déterminent le caractère du code pénal de l’Empire de 1787, dont l’application avait pour but, une fois de plus, d’intégrer la Transylvanie.
Une des mesures les plus discutées (dès l’époque qui nous occupe, et de nos jours encore) de celles que prit Joseph II fut l’introduction de l’allemand comme langue officielle unique, mesure motivée par sa volonté d’unifier l’administration de l’Empire mais aussi par sa conviction, justifiée, que le latin n’était plus apte à faire fonction de langue officielle commune. Dans l’administration centrale, l’allemand gagne du terrain et s’impose de plus en plus. Il est donc logique de le substituer, dans la pratique administrative de Hongrie et de Transylvanie également, au latin officiel. Mais 12% seulement de la population transylvaine est germanophone, tandis qu’un pourcentage beaucoup plus important parle le hongrois et une majorité absolue le roumain. Substituer à une langue ancienne périmée, qui avait l’avantage de n’être la langue d’aucune des ethnies, l’idiome de l’ethnie la moins nombreuse constitua une solution qui ne réussit même pas à rallier les Saxons modérés. Aux termes du décret de 1784, les affaires devaient être traitées en allemand non seulement dans les organes administratifs, mais aussi au niveau des instances municipales et dans les villes; l’Empereur allait même décréter l’allemand langue officielle de la Diète qu’il se refusa par ailleurs à convoquer pendant tout son règne. A partir de l’automne 1784, aucun élève ne pouvait être admis dans une école secondaire sans avoir prouvé sa capacité à lire et à écrire l’allemand. L’application du décret fut cependant peu conséquente: le Gubernium émettait ses circulaires-instructions rédigées en deux colonnes, l’une en allemand, l’autre en hongrois (ou quelquefois en latin); dans les instances inférieures, l’utilisation de l’allemand posait de sérieux problèmes. En fin de compte, le décret n’eut d’autre conséquence durable, en Transylvanie, que le renforcement considérable du nationalisme hongrois.
Une sorte de résistance au joséphisme se produisit même en Transylvanie, résistance qui amalgamait le conservatisme et les exigences nouvelles. Elle apparaît avec une certaine force dans les mémorandums des Ordres de 1787, à la préparation desquels la quasi totalité des couches dirigeantes des trois «nations» apporta sa participation. Mais leurs consultations s’étendant sur {f-428.} plusieurs mois, celles-ci ne purent aboutir à un texte commun: Hongrois et Sicules firent conjointement écho de leurs griefs, tandis que les Saxons les formulèrent séparément et avec davantage de modération.
Le document hongrois-sicule part du postulat que les Ordres sont membres de la communauté de la Sainte Couronne et, en tant que tels, ils jouissent du même droit de légiférer que le roi. Or, sous Joseph II, les lois fondamentales et tout le système d’Etat ont été bafoués: la Diète n’est pas convoquée; on a supprimé le système des trois «nations»; l’institution de «concivilitas» donne aux nouveaux venus les mêmes droits qu’aux Ordres qui perdent leur autorité jusque dans les comitats. Chacun se sent particulièrement lésé par l’introduction de l’allemand en tant que langue officielle: les Hongrois sont devenus des étrangers dans leur propre patrie, écrit-on, et le changement de langue n’est qu’un prélude à la perte de toutes les libertés.
C’est grâce aux fréquentes modifications dans le régime d’administration, dit le mémorandum, que put éclater la révolte de Horea et Cloşca. Puis celui-ci déplore que la masse des serfs, voyant que les auteurs de ces crimes odieux n’étaient pas poursuivis avec toute la rigueur de la loi et que la peine capitale était abolie, n’en prît que davantage d’audace. La sécurité de la vie et des biens ne pouvait être assurée sans le rétablissement de l’autorité des seigneurs et des officiers de la noblesse. Touchant à un point sensible, il conteste l’utilité de la liberté de mouvement des serfs en avançant l’argument que leur attachement à la glèbe les stimulait davantage à la construction, aux techniques d’amélioration et au fumage. Dans un raisonnement arbitraire mais non sans poids, il est jugé inopportun que les serfs puissent croire que l’abolition de l’attachement à la glèbe est le résultat de leur soulèvement, alors même que les services n’ont pas été réglementés. La tentative centrale qui vise à le faire est particulièrement critiquée pour ses faiblesses réelles et imaginaires. La noblesse terrienne se considère comme atteinte par le décret royal du 14 juin 1786 qui supprime l’affermage aux seigneurs de la dîme due au Trésor et la remplace par la perception directe en nature.
Un des griefs habituels de la noblesse est que l’établissement des impôts échappe à l’autorité de la Diète et que le principe «onus non inhaeret fundo» se trouve violé. En matière de guerre, une mesure qui date d’avant Joseph II est jugée préjudiciable: c’est la mise sur pied de la garde-frontières. L’enrôlement des Sicules est rejeté sur la base d’un argument de droit constitutionnel les Sicules ne peuvent être à la fois imposés et astreints au service armé; d’autre part, la création de la garde-frontières a renversé le statut juridique de la Terre sicule et y a mis en place d’absurdes conditions de propriété. L’existence d’une garde-frontières roumaine semble par contre dangereuse car, comme l’expose le mémorandum, il y a tout à craindre qu’elle ne se serve de ses armes dans des émeutes, ou ne les retourne, en s’unissant aux Roumains de Valachie ou du Banat, contre le pays. (Notons que des gardes-frontières du Banat ont participé à l’écrasement du soulèvement de Horea-Cloşca et que nul projet d’action concertée entre Roumains de Transylvanie, du Banat et de Valachie ne fut tramé au cours de cette période.)
On pourrait croire que ce mémorandum aurait pu servir de programme à la noblesse. Mais, après 1790, quand les personnalités dirigeantes de la vie politique transylvaine auront la possibilité de se manifester, ou du moins de s’exprimer publiquement, elles feront preuve de modération en appréciant les innovations du joséphisme avec beaucoup plus de réalisme que ne le faisait le mémorandum.
La lettre de doléances des Saxons est terminée à la fin de 1787. Bien que {f-429.} d’un ton plus modéré que celle des deux autres nations, elle est en même temps plus conservatrice par son contenu.
L’Empereur rappelle les auteurs des mémorandums à la modération, par l’intermédiaire du chancelier de Hongrie-Transylvanie. Mais le mécontentement ne cesse de croître, surtout lorsque, en 1788, Joseph II entre, aux côtés des Russes, en guerre contre l’Empire ottoman et que les conséquences négatives des opérations (approvisionnement militaire, incursions des Turcs) commencent à se faire sentir. Mais si le système joséphiste s’écroule, ce n’est ni à cause de la Transylvanie, ni en Transylvanie. C’est en fait le résultat d’une série de facteurs: l’insurrection aux Pays-Bas, l’échec de la guerre turque, les rapports conflictuels avec la Prusse et un mécontentement intérieur croissant, surtout en Hongrie. Et ce n’est qu’au cours des décennies suivantes qu’on saura la part du joséphisme qui s’est perdue et la part qui s’en est maintenue, tant dans l’Empire qu’en Transylvanie.
Signant, sur son lit de mort, un Restitutionsedikt qui révoquait la plupart de ses décrets innovateurs, Joseph II condamna lui-même son système à l’échec.
Réaction des Ordres et mouvement réformiste
Les événements consécutifs au Restitutionsedikt reflètent à la fois la réaction des Ordres, c’est-à-dire des efforts pour restaurer l’état antérieur, et les luttes du joséphisme pour sauvegarder les acquis d’une politique éclairée. On observe même parfois des tentatives réformistes qui se veulent plus radicales que le joséphisme. De plus, en 1790, les mouvements nationaux connaissent une recrudescence et exercent un effet tantôt stimulant, tantôt inhibitif sur les tendances que nous venons de décrire. Enfin, le tout reste toujours dépendant des évolutions d’une politique centrale, qui régresse de l’absolutisme éclairé, réaliste de Léopold II vers le conservatisme réactionnaire de François Ier.
La restauration des droits semble la plus simple à réaliser au niveau du système municipal et pour la «nation» saxonne: le réseau des comitats et des districts des commissaires créés par Joseph II se dissout, et l’Universitas saxonne revoit le jour. La plate-forme des Saxons repose sur une triple base loyauté aux Habsbourg, bons rapports avec la noblesse, maintien de l’union des trois «nations».
Les deux autres «nations» – hongroise et sicule – tentent de voir plus loin et cherchent à se protéger institutionnellement. Pour répondre à leur objectif primordial, elles demandent l’union avec la Hongrie, qui leur semble la meilleure garantie de la protection des droits des Ordres en même temps que des aspirations nationales déjà conçues dans un sens quasi bourgeois. Mais la première bataille, menée à la Diète de Hongrie en vue de l’union, se solde par un échec. En effet, les milieux gouvernementaux ont déjà adopté le principe «divide et impera»; ainsi Léopold II remet la question devant les Ordres transylvains et se fait couronner roi de Hongrie sans déclarer l’union. Entre-temps, la population paysanne de Transylvanie commence à s’inquiéter: elle craint que les Ordres n’aillent anéantir les allégements des services féodaux obtenus à l’époque joséphiste. D’autre part, les Ordres hongrois et sicules commencent à s’armer avec, parfois, une tendance nettement anti-Habsbourg et ce n’est que la sage tempérence du Gubernium présidé par György Bánffy qui peut empêcher les confrontations qui risquent de se déclencher par peur réciproque.
{f-430.} Quand, en décembre 1790, se réunit enfin la Diète de Transylvanie aussi, les Ordres se consacrent tout d’abord aux questions de la restauration des «formes constitutionnelles». Néanmoins, ils ont la sagesse de réélir György Bánffy, le plus éminent homme d’Etat joséphiste de Transylvanie, au poste de gouverneur qu’il occupe depuis des années. Mais un groupe oppositionnel exige, immédiatement après, l’établissement de la responsabilité des hauts officiers de l’administration ayant causé des torts aux Ordres, et la Diète demande au Gubernium des éclaircissements sur les projets de loi pouvant porter préjudice au pays. Mélange curieux où la protection des droits des Ordres se double de l’insistance sur la responsabilité gouvernementale.
Plus positive est la législation des Ordres faisant du hongrois la langue officielle et touchant au développement de la culture hongroise. Les procèsverbaux de la Diète sont désormais rédigés en hongrois; on discute le projet de György Aranka sur une Société Transylvaine pour le Soin de la Langue Hongroise, la première association ayant les traits d’une académie qui ait pu être mise sur pied en Transylvanie.
Le troisième thème majeur traité dans cette première phase de l’assemblée fut le problème de l’union avec la Hongrie. L’obstacle à surmonter était non seulement l’hostilité des Saxons, mais aussi l’aversion d’une partie des Sicules qui craignaient de vivre dans un pays réunifié, où ils pourraient perdre leurs privilèges particuliers, et redoutaient aussi, en tant que protestants, la dégradation de leur situation. Mais quand la Diète commence son débat sur l’union, Léopold II a déjà pris sa décision (25 février 1791) de séparer à nouveau les Chancelleries Auliques de Hongrie et de Transylvanie, ce qui ne signifiait rien d’autre que l’abandon de l’union. Ignorant tout cela, la Diète formule des propositions sur les modalités de l’union, propositions qui ne vont pas très loin: inclure nommément la Transylvanie dans le serment royal de Hongrie, assurer au gouverneur le droit de siéger dans les Diètes hongroises, confirmer les mesures unificatrices de Joseph II (union des deux chancelleries, suppression des barrières douanières). Mais Léopold II les rejette toutes.
Enfin, au début d’avril 179 1, on ouvre la discussion sur les initiatives royales visant à réglementer l’administration et les conditions serviles. Un travail de législation s’amorce alors, comme on n’en a jamais vu, ni ne verra plus dans l’histoire des Diètes transylvaines. Le résultat: 162 projets de loi, tout un code logique et cohérent, la dernière constitution de la Transylvanie féodale.
Parmi les articles définissant le statut juridique de la Transylvanie, le n° II déclare que, si la Transylvanie est une possession des Habsbourg, c’est en tant que partie de la Couronne de Hongrie et en vertu de leur royauté hongroise et qu’elle ne peut être administrativement rattachée à aucun autre territoire de l’Empire.
Trente-sept propositions virent le jour sur les questions suivantes: le serment royal sur l’union, le partage du pouvoir législatif entre le souverain et les Ordres, le régime des diètes, l’immuabilité des droits des Ordres, l’éligibilité aux charges et fonctions (avec des restrictions pour les hobereaux sans terre et les bourgeois non saxons, et à l’exclusion totale de ceux qui n’appartiennent ni aux Ordres nobiliaires, ni aux bourgeois), leur droit d’élire les grands du pays (le roi devant se contenter de les confirmer), le maintien de la Chancellerie unifiée de Hongrie et de Transylvanie.
Des lois sur les serfs sont également insérées parmi les réglementations des droits des Ordres. L’assemblée fait preuve de modération en ce qui concerne la liberté de mouvement des serfs par l’abolition du servage perpétuel; mais {f-431.} elle impose des conditions sévères aux déménagements. Elle établit également le droit de propriété exclusif des seigneurs sur les forêts.
Sur le plan de la législation culturelle, un article privilégie le hongrois au dépens des autres langues et le déclare langue officielle de la Transylvanie; un autre décide le soutien du projet d’une Société Transylvaine pour le Soin de la Langue Hongroise.
La question des impôts fut amplement débattue par les Ordres qui exigeaient le retour au principe de «onus non inhaeret fundo» et le rétablissement de l’immunité de la nobles d’Eglise, des armalistes, des «primipili» et des Sicules communs ainsi que de certains lieux privilégiés; ils s’attribuèrent le droit de déterminer chaque année le montant de l’impôt et d’assurer sa perception.
Plusieurs lois de première importance furent votées par la Diète en matière de religion. On codifia à nouveau le système des quatre confessions reçues et, en même temps, on assura le libre exercice de la religion orthodoxe «rangée parmi les religions tolérées». On dépassa même en libéralisme l’édit de tolérance joséphiste en reconnaissant aux enfants nés de mariages mixtes la confession de leur parent du même sexe.
Dans le même temps, la Diète devait faire face au mouvement national des Roumains: elle reçut de Vienne un document qui récapitulait les revendications roumaines: le Supplex Libellus Valachorum.
Depuis 1748, le mouvement des Roumains de Transylvanie n’avait entrepris, pendant des dizaines d’années, aucune action politique directe. Mais il s’y était préparé: l’apparition d’une couche plus large d’intellectuels roumains, le raffermissement de la conscience nationale grâce aux ouvrages qui propageaient la théorie de la continuité, l’effort des Roumains d’accéder à des postes élevés en étaient les signes. Il en résulta, dès 1789, une agitation croissante parmi les intellectuels uniates ecclésiastiques et laïcs, agitation qui déboucha sur la rédaction du Supplex.
Cette requête constitue l’écrit politique le plus important des Roumains de Transylvanie au XVIIIe siècle. Fruit d’un effort collectif, sa conception se rattache à deux centres spirituels: l’un se trouve à Nagyvárad, autour de l’évêque uniate Ignatie Darabont, l’autre se constitue à Vienne; son animateur principal est Josif Méhesi, ses arguments historiques remontent indirectement aux idées de Samuit Micu-Klein. Sa rédaction est terminée en mars 1791. L’argumentation historique avancée par le document s’appuie sur la théorie de l’origine romaine et de la continuité et en reproduit également les faiblesses. A l’époque de la naissance des nationalismes à caractère bourgeois, on se servait de l’histoire comme d’un recueil d’exemples et on s’efforçait de créer des mythes au détriment ou contre la réalité historique. Le Supplex Libellus Valachorum a cependant un argument de poids, qui est d’une validité incontestable, à savoir que les Roumains sont l’ethnie la plus nombreuse de Transylvanie. Il exige donc que les Roumains soient reconnus comme une quatrième «nation», que leur clergé, leur noblesse et leur peuple jouissent des mêmes droits que les groupes identiques des trois autres «nations», que la langue roumaine soit employée parallèlement, ou même exclusivement, dans les municipalités et localités majoritairement ou entièrement roumaines. En 1791, les revendications du nationalisme roumain n’ont pas encore un caractère bourgeois et le Supplex Libellus Valachorum se contente de demander, pour les Roumains, une place au sein du système des Ordres. Les évêques uniates et orthodoxes, par exemple, s’adressent au souverain en avançant que «le droit fondamental de tout citoyen de Transylvanie, c’est de se faire représenter {f-432.} proportionnellement sur le plan législatif et d’élire à cette fin des députés à l’assemblée ainsi que des fonctionnaires d’Etat, ou d’être élus comme tels».* Mais les Hongrois, c’est-à-dire les seigneurs terriens, ne permettent qu’à très peu de Roumains d’accéder à des fontcions, et c’est là que réside la source de l’oppression si lourde et prolongée de la «nation» transylvaine numériquement la plus importante. En effet, selon la conception féodale de la légalité, la noblesse hongroise pouvait déclarer l’égalité des droits pour tous les nobles, membres de la «nation», et nier l’existence d’une noblesse roumaine distincte. Ainsi, les auteurs du Supplex ne pouvaient guère espérer l’admission de leur «nation» en tant que quatrième membre du «système trinational».
Parallèlement au Supplex Libellus Valachorum, le clergé orthodoxe envoie lui aussi sa requête au souverain avec les mêmes revendications fondamentales mais sans les étayer de la thèse de la continuité.
Léopold fait transmettre les deux requêtes à la Diète dans le seul dessein de lui faire endosser la responsabilité du rejet. La lecture du Supplex est suivie d’un lourd silence: les Ordres se rendent à l’évidence du problème national roumain. Après délibération, la Diète se prononce: sur les territoires des «nations» hongroise et sicule les Roumains ne pourront obtenir davantage de droits civiques, puisque les personnes nobles ou affranchies jouissent partout des mêmes libertés, indépendamment de leur appartenance ethnique, tout comme les serfs ont les mêmes charges. Les Saxons, eux, remettent à plus tard leur prise de position. Sur le plan religieux les uniates peuvent déjà exercer librement leur foi et un projet de loi est présenté en vue d’assurer également ce droit aux orthodoxes. L’inculture du peuple roumain, à leur avis, est due à l’ignorance de ses prêtres, ce à quoi le remède devra être trouvé par la commission régulière des affaires religieuses.
La tentative d’enfoncer les murs a donc échoué. On pouvait s’y attendre en ce qui concerne la revendication de l’égalité des droits féodaux. La liberté d’exercice des deux Eglises roumaines était un fait dont on pouvait se réclamer face aux requérants. Bref, il s’avéra impossible, pour les Roumains, de se faire une place parmi les autres «nations».
Les propositions de loi de la Diète de 1790-91 furent passées au crible par le gouvernement central. La proposition de l’union avec la Hongrie est remplacée par une autre, qui déclare pratiquement la séparation de la Transylvanie. Il n’est pas question de codifier le caractère immuable des droits et privilèges fondamentaux des Ordres. Le gouvernement ne fait pas de concession en matière de droits souverains, exercés d’une manière absolutiste, ni n’allège les contrôles interminables des voyages d’études à l’étranger, objet de tant de récriminations. Le texte dans lequel il déclare le hongrois langue officielle, prête tellement à équivoque qu’on pourra l’utiliser par la suite en faveur du latin. Il n’écarte cependant pas l’idée de rétablir certains droits. L’organisation juridique, par exemple, est reconstituée dans son état antérieur, conformément au Restitutionsedikt. En matière de religion, la plupart des propositions des Ordres sont approuvées par le gouvernement, y compris le libre exercice de la religion orthodoxe. Les commissions régulières déléguées pour étudier les propositions seront placées sous la direction de György Bánffy qui choisira partout huit personnes parmi les élus pour les travaux concrets, ce qui lui permet d’écarter les oppositionnels.
{f-433.} Les luttes autour des propositions de 1790-91 se poursuivront encore au cours des deux Diètes suivantes sans aboutir cependant à des résultats concrets. En 1794-95, l’atmosphère est encore plus tendue. Au début de 1794, on met sur pied, avec la participation d’aristocrates et de nobles «moyens», la société de chasse «Diana» avec un programme qui annonce déjà en quelque sorte l’ère des Réformes (traduction de livres d’agronomie, développement de l’élevage des chevaux, éducation de la jeunesse aux bonnes mśurs, rapprochement social entre haute et moyenne noblesses, etc.). Mais le Gubernium devient attentif à ce programme où prévaut l’élément politique et Bánffy donne aux «chasseurs» le bon conseil de prononcer leur dissolution avant qu’ils n’encourent des ennuis, et ils le suivent.
En été 1794, le mouvement des jacobins de Hongrie fait également son apparition en Transylvanie. La noblesse terrienne d’opposition entreprend, dans quelques comitats, des actions: elle s’oppose au recrutement de soldats, fait rentrer chez eux les nouveaux conscrits et refuse de fournir les subsides de guerre. Le index curiae László Türi, le plus intègre des dirigeants de l’opposition, élabore, assisté par d’autres, un projet global pour la réforme de l’armée en Transylvanie (mise sur pied d’une armée de 4 000 mercenaires recrutés parmi les paysans, et d’une armée nobiliaire de 4 000 hommes relayés tous les mois et placés sous la direction des généraux des «nations» et du commandant du pays). Le projet fut présenté à la Diète, mais le gouvernement intervint promptement car même Bánffy croyait savoir qu’une société qui avait adopté les principes de la Révolution française préparait «l’explosion générale», et le commandant affirmait que les dirigeants du mouvement et les Ordres étaient à même d’armer 48 000 hommes (alors même qu’en Hongrie, les Jacobins étaient déjà arrêtés). Quand Bánffy se rendit compte qu’il n’y avait pas de danger d’«explosion» en Transylvanie, il se contenta de relever Türi de son poste et de classer l’affaire. C’est donc grâce à la tactique habile du gouverneur qu’aucun procès jacobin n’eut lieu en Transylvanie à cette époque.
Les travaux des commissions régulières déléguées en 1791 par la Diète reflètent fidèlement l’évolution de la pensée politique transylvaine, tant au sein des Ordres qu’au niveau du gouvernement, toutes ces actions étant orchestrées par György Bánffy, qui était doté d’un sens politique exceptionnel.
Le problème paysan n’a toujours pas trouvé de solution adéquate. A trois reprises déjà, le gouvernement central, de concert avec l’administration locale, a tenté de réglementer les charges serviles, pratiquement sans résultat. Après 1791, on bute toujours sur des mêmes écueils: la Transylvanie souffre d’un surpeuplement de type féodal. La commission fixe l’étendue d’un cens entier à 3,5-6 acres de champ et à 1,5-3,5 acres de prés, en contrepartie desquels on exige une corvée hebdomadaire de 2 journées à bête ou 3 journées à la main (pour les serfs sans tenure, la corvée annuelle était de 25-35 journées à la main). Ayant à nouveau examiné la question, le Gubernium veut élever la surface retenue pour les champs à 5-7,5 (dans certains cas à 10) acres, et à 2,5-6,5 acres pour les prés. La Chancellerie adopte, pour l’essentiel, le point de vue du Gubernium. A la Diète de 1810-11, les propositions ne furent discutées que par une commission préparatoire. Finalement, ni la commission de travail, ni les organes administratifs et la commission diétale chargés de contrôler celle-ci ne réussirent à quitter la fausse route des années 1770.
Le travail des commissions diétales fournissait par ailleurs des matériaux propre à remplir toute une bibliothèque, documents desquels se dégageait un vaste tableau des conditions de vie de l’époque. En effet, ces commissions {f-434.} proposèrent des solutions tout à fait conformes à leur temps, bien que restant dans le cadre du féodalisme, pour la presque totalité des problèmes aigus, de la pollution de l’environnement jusqu’à l’atténuation des mesures discriminatoires à l’égard de certains groupes ethnico-professionnels, tels les Juifs ou les Tziganes.
Le vaste programme économique, dont la partie centrale comprenait les idées de Joachim Bedeus, fils de patriciens éclairés de Beszterce, fut la meilleure récapitulation des données économiques de la Transylvanie depuis 1751. Il cherchait surtout à apporter une solution en augmentant la production. Cependant, ses propositions concentrées sur la Transylvanie et suggérant des rapports douaniers symétriques avec les pays héréditaires, parurent d’emblée inacceptables au gouvernement central.
Le chef de file de l’opposition, László Türi, mit au point un projet de code pénal qui, de par son caractère éclairé, peut à juste titre être comparé au code joséphien et, s’il y eut recul par rapport à celui-ci, Türi n’en était pas responsable. De plus, son projet eût pu être appliqué en Transylvanie beaucoup plus aisément que le code en question.
Fort typique était le procédé «aufkläriste» par lequel une commission de politique religieuse dut résoudre les problèmes soulevés en rapport avec le Supplex Libellus Valachorum, en ce qui concerne notamment le relèvement du niveau culturel des Roumains. La «nation» saxonne, soit le conseiller Michael Soterius en personne, se prononça pour leur acculturation par la contrainte stricte réglementation de leurs constructions et de leur habillement, introduction chez eux de certaines institutions saxonnes, assimilation forcée, «réforme» de leurs divertissements (interdiction par exemple, de chanter les ballades sur les bandits célèbres). Le savant juriste Mózes Bartha, conseiller municipal unitarien de Kolozsvár, avança un projet où prédominaient l’enseignement (avec des éléments de hongrois), la réforme intérieure de l’Eglise roumaine et l’éducation artisanale. Le président joséphiste de la commission, János Eszterházy, de même que Bánffy lui-même, mit l’accent sur l’éducation dans l’optique de former moins des individus cultivés que des citoyens loyaux; aussi la formation des prêtres y occupait une place importante. Leur conception finit par l’emporter. On ne tenta même pas de conférer une dimension politique à la question nationale roumaine, et encore moins de consulter directement les habitants, d’en faire les interlocuteurs directs. En fait, la commission ne comprenait aucun membre roumain.
Ayant passé par les diverses instances gouvernementales, le projet se réduisit finalement à une seule proposition visant la création d’un séminaire pour la formation des prêtres et instituteurs orthodoxes.
Ce n’est qu’en 1810 que les commissions purent soumettre leurs propositions à la Diète, à une date où les grandes personnalités politiques des années 1790 étaient déjà mortes ou fort âgées. Aussi la législation de 1810-11, en comparaison du projet original, s’avéra-t-elle conservatrice et loyale envers Vienne. En définitive, le bilan de ces vingt années sera globalement négatif.
Ainsi, en Transylvanie, jusqu’aux années 1830, pour pouvoir s’activer sur la scène publique, il fallait convertir en effort culturel ce qui avait tout juste été amorcé en politique.
{f-435.} Tentatives culturelles et absolutisme bureaucratique
La pénétration en Transylvanie des acquis intellectuels européens exerça son effet sur l’ensemble de la vie culturelle. En philosophie, la pensée nouvelle s’appelle kantisme. C’est à partir des idées du philosophe de Königsberg et en s’inspirant également de Fichte et Schleiermacher, que Pál Sipos, qui jouissait d’une renommée internationale en tant que mathématicien, élabore sa propre philosophie, un idéalisme moral qui concilie christianisme et Lumières. Professeur au collège réformé de Marosvásárhely, puis à celui de Nagyenyed, Sámuel Köteles se familiarisa lui aussi avec les idées de Kant et s’en fit le propagateur en Hongrie et en Transylvanie.
Vers 1790, s’amorce un processus de remplacement du baroque par le classicisme; celui-ci transforme progressivement, et sans rupture aiguë, notamment la construction des hôtels particuliers aristocratiques dans les villes.
En sciences naturelles également, la Transylvanie rejoint le niveau européen. Après vingt ans d’investigations en botanique, Johann Christian Baumgartner publie la première partie de sa grande ceuvre de synthèse Enumeratio Stirpium in Magno Transylvaniae Principatu praeprimis indigenarum. A partir de 1804, le collège réformé de Marosvásárhely compte parmi ses professeurs Farkas Bólyai, ancien condisciple de Gauss, personnalité aux talents multiples, qui y dispense un enseignement de niveau européen. La médecine transylvaine adopte avec une rapidité exceptionnelle les résultats les plus modernes. C’est, par exemple, avec un an de décalage seulement qu’on introduit la vaccination contre la variole. Plusieurs savants ont étudié les eaux minérales de Transylvanie, tout d’abord, en 1800, Ferenc Nyulas (qui était également le promoteur du vaccin antivariolique), puis, en 1821, Vasile Popp, médecin des mines à Zalatna, auteur du premier ouvrage de médecine en roumain. Popp avait précédemment consacré sa thèse de doctorat aux rites funéraires populaires roumains, frayant ainsi une voie à l’ethnologie, et on lui doit également la première bibliographie des ouvrages roumains.
C’est à cette époque qu’on entreprend de jeter les bases institutionnelles des cultures nationales. La Diète de 1790-91 s’était déjà penchée sur l’initiative de György Aranka visant la création d’une Société transylvaine destinée à «cultiver» le hongrois. Cette organisation, la première à avoir un caractère académique, reçoit le soutien de la Diète, mais se voit refuser, pour des raisons formelles, l’autorisation du gouvernement central. Cependant, grâce à György Bánffy, elle existe, de 1793 à 1806, en tant que société «à l’essai». Elle regroupe surtout des Hongrois, mais maintient des rapports, entre autres, avec le Saxon Martin Hochmeister, qui publie les écrits des membres de la Société dans Siebenbürgische Quartalschrift, à Nagyszeben. Elle compte également, parmi ses adhérents, le Roumain Ioan Piuariu-Molnár. La Société appuie avec ardeur l’activité théâtrale de Kolozsvár, pour laquelle plusieurs de ses membres, dont Aranka lui-même, traduisent des pièces. Bon nombre de leurs idées restent à l’état de projets, tels la description systématique de la flore et des minerais de Transylvanie, l’enseignement plus généralisé des sciences naturelles, l’exhortation à l’utilisation des richesses naturelles. Figurait aussi, parmi les projets de la Société, la fondation d’une bibliothèque et d’un musée national (chez les Saxons, la collection Bruckenthal remplissait déjà cette fonction). Ayant connu, après 1800, une nette baisse de son activité, la Société cesse d’exister en 1806 faute de contributions spirituelles et matérielles, mais aussi en raison de la dégradation générale de l’athmosphére politique. Elle a {f-436.} également engendré une Société d’Edition des Manuscrits qui n’a cependant pu publier qu’à peine quelques volumes.
La culture hongroise de Transylvanie fut grandement stimulée par ses contacts avec la Hongrie. Gábor Döbrentei, fils de pasteur luthérien né en Hongrie, mais qui s’installa comme précepteur en Transylvanie, lance, en 1814, sous les exhortations de Ferenc Kazinczy, organisateur de toute la vie spirituelle hongroise, une revue intitulée Musée Transylvain, qui deviendra le périodique hongrois le plus important de l’époque. Sa réussite peut être attribuée tant à la persistance en Transylvanie des traditions franc-maçonniques, favorables à la culture, qu’au fait que l’aristocratie, réduite à une position périphérique, y était davantage attachée à sa langue que ses homologues de Hongrie, et pouvait donc fournir un appui aux gens de lettres de l’époque. La concurrence de la presse de Hongrie, allant de pair avec la famine de 1817, finit par asphyxier la revue.
Mais la meilleure des énergies est investie dans le théâtre, qui s’ancre fortement dans la vie sociale. Le théâtre hongrois de Transylvanie a pour antécédent la vigoureuse tradition théâtrale des collèges protestants. Les premiers grands noms de l’art dramatique hongrois: János Kótsi Patkó, Pál Jantsó, József Benke sont des Transylvains protestants. C’est à Kolozsvár que le théâtre de langue hongroise, en ascension fulgurante, trouvera son premier foyer permanent dans le bâtiment de la Scène Nationale Hongroise, achevé en 1821. S’il a pu se maintenir en vie jusqu’à cette date, le mérite en revient essentiellement à Miklós Wesselényi père, figure éminente de la résistance nobiliaire. Mais la troupe bénéficie également du soutien du gouverneur Bánffy et de son épouse Jozefa Palm, issue de l’aristocratie austro-bohémienne.
Bien que la langue reste, en Transylvanie aussi, un des objets principaux des préoccupations culturelles, les plus prestigieux exploits sont nés, en matière linguistique, en dehors des frontières du pays, en raison notamment du fait que le régime ne parvient pas à couper les contacts avec l’étranger. C’est en 1799 que paraît le chef-d’śuvre du Transylvain Sámuel Gyarmathi Affinitas Linguae Hungaricae, qui établit la parenté morphologique et lexicale du hongrois avec l’ensemble des langues finno-ougriennes et fait de son auteur l’un des grands précurseurs de la linguistique comparée.
L’autre figure éminente de cette discipline, Sándor Körösi Csorna quitte, également pendant cette période, la Transylvanie pour aller retrouver, en Asie Orientale, la patrie ancestrale supposée des Hongrois et réalise, au lieu de son dessein initial, le premier dictionnaire anglais-tibétain.
Moins notable est l’activité culturelle des Saxons. Szeben, d’où le Gubernium était parti pour Kolozsvár, se trouve, en conséquence, privée de ses stimulations culturelles. On a beau y projeter une Académie des sciences, elle ne verra jamais le jour. Comme pour la remplacer, se constitue la Societas Philohistorum qui commence son activité en éditant des chroniques transylvaines. Parmi les revues saxonnes, la Siebenbürgische Quartalschrift survit jusqu’en 1801, sa succession étant assurée par les Provinzialblätter (1805-1824).
Née dans des conditions fondamentalement défavorables, la culture roumaine de Transylvanie put cependant enregistrer des résultats remarquables. Ceci, il est vrai, moins en Transylvanie qu’à Buda et Lemberg. Micu, Şincai et Maior, la fameuse triade, eurent des différends avec la direction de plus en plus conservatrice de l’Eglise uniate et en particulier avec l’évêque Ioan Bob, qui gérait d’une main heureuse les biens de l’Eglise, mais se voulait maître {f-437.} incontestable en culture et était jaloux du talent des autres. Ils s’engagèrent alors à l’Imprimerie universitaire de Buda qui jouait également, notamment par sa production de livres roumains, le rôle de centre culturel pour les Principautés danubiennes. (Les riches boyards de Moldavie et de Valachie y publiaient volontiers des śuvres littéraires et, plus tard, des écrits politiques dans lesquels ils justifiaient les droits nationaux de leur peuple.) Fait caractéristique: Ioan Piuariu-Molnár, qui a vainement tenté, en Transylvanie, de publier un journal-almanach populaire et de fonder une société savante philosophique, trouve, après l’échec de sa manufacture de drap, une excellente affaire dans la publication, à l’imprimerie de Buda, d’ouvrages théologiques orthodoxes destinés à l’ensemble des territoires d’idiome roumain. Alors que l’homme de compromis que fut Samuil Micu-Klein, et le non-conformiste et prémoderne Gheorghe Şincai ne réussirent à publier qu’une partie de leurs travaux, le tacticien Petru Maior devint l’auteur roumain le plus fécond et le plus lu de l’époque. C’est lui qui a su transmettre avec le plus de bonheur à la postérité l’enseignement de l’époque sur l’histoire en publiant, en 1812, son śuvre majeure sur les origines des Roumains de Transylvanie (Istoria pentru începutul Românilor în Dacia). L’histoire de la Transylvanie y est traitée jusqu’à sa conquête par les Hongrois, conformément à l’historisme pragmatique de l’époque qui savait polémiquer avec civilité et évitait d’accuser autrui des avatars de l’histoire roumaine. Cet ouvrage sera, pour la future génération en-deçà et au-delà des Carpates, une véritable Bible.
Parmi les premiers produits importants des lettres roumaines de Transylvanie, le plus remarquable est de loin la Ţiganiada de Ioan Budai Deleanu. Figure éminente des Lumières roumaines, celui-ci participa également aux affrontements qui se déroulaient autour du Supplex en publiant son Widerlegung, réponse aux polémiqueurs adversaires de la continuité. Il fut également l’auteur d’une nouvelle Requête roumaine à sa Majesté, en 1804. Mais c’est surtout sa Ţiganiada qui lui valut sa renommée. Il s’agit là d’une «antiépopée» d’un ton âpre sur les Tziganes auxquels le prince valaque Vlad Ţepeş, cruel et énergique adversaire des Turcs, offre la possibilité de fonder un Etat indépendant et demande en échange leur aide contre les Ottomans. Mais les Tziganes, peu portés aux sacrifices héroïques, sont d’autant plus prompts à se lancer, dès la diminution du danger turc, dans d’interminables discussions sur la Constitution de leur futur pays: sera-t-elle démocratique ou monarchique? Les partisans des deux solutions refusent, les uns comme les autres, de partager le pouvoir et finissent par retomber dans l’anarchie traditionnelle, laissant échapper l’unique occasion de s’offrir un Etat. Tels sont les enseignements amers que le «joséphiste» vieillissant, s’étant même entiché de jacobinisme, adressa, depuis sa solitude de Lemberg, à sa propre nation ainsi qu’aux autres.
Dans la vie culturelle roumaine, la satisfaction des besoins en lecture «du peuple» fut la tâche des auteurs orthodoxes. Alors que l’Imprimerie universitaire de Buda dispense une culture savante ou de vulgarisation et d’application concrète en matière d’économie agricole, les imprimeries de Nagyszeben et de Brassó publient des «livres populaires» destinés à des couches intermédiaires et sortis de la plume de Vasile Aron et Ioan Barac, ce dernier étant empreint d’une culture nettement hongroise. Directeur des écoles populaires orthodoxes roumaines, Radu Tempea adopta, dans sa grammaire, la tendance latinisante, tout en renonçant, en considération de la modestie des besoins du peuple, à ses ambitions puristes.
L’étroitesse des conditions se fait aussi sentir au sein de l’Eglise orthodoxe. {f-438.} La pression exercée par les uniates ne cesse de s’accroître. Afin de surmonter la division confessionnelle et de faire valoir l’intérêt national, le frère de Ioan Budai-Deleanu, Aron, secrétaire de consistoire et conseiller au Trésor, secondé par Tempea ainsi que par un prélat, suggère au gouvernement de Vienne, en 1789, de procéder à une union, catholique dans sa dénomination, mais conservant le rite et le droit canon orthodoxes et assurant à l’Eglise une plus grande autonomie. Considérant la situation internationale comme difficile, et redoutant les agitations populaires, le Gubernium rejette la proposition. Ainsi, l’Eglise orthodoxe doit continuer à endurer les assauts des uniates. Cependant, ou peut-être justement pour cette raison-même, les orthodoxes jouent un rôle de stimulant dans l’épanouissement culturel roumain au-delà des Carpates. De la génération de la fameuse triade, seul Piuariu-Molnár se rend dans ces régions; il soulignera par la suite avec amertume, dans son avertissement visiblement adressé à Vienne, qu’étant donné l’émigration massive des hommes cultivés, ce sont les Principautés qui tirent les bénéfices de la scolarisation en Transylvanie. Gheorghe Lazăr, lui, s’étant brouillé avec son évêque, partit dans les années 1810 pour Bucarest et y organisa, en substitution au grec, l’enseignement supérieur en roumain, activité à laquelle devaient se dévouer par la suite tant d’intellectuels transylvains émigrés.
Si l’on se rend compte du rôle que la Transylvanie a joué dans le développement des cultures hongroise et roumaine, on comprend pourquoi l’opinion, dans les deux pays, considérait cette Principauté comme incarnant à la fois les traditions ancestrales et les nouvelles valeurs nationales. Mais, avant que ces prises de position fussent clairement exprimées, la Transylvanie dut connaître une vingtaine d’années de dépolitisation presque totale. Un seul événement à caractère politique est à noter dans les années 1810: une nouvelle tentative – déjà la cinquième – de réglementer les services féodaux. La diète de 1810-11 ne discute par sur le fond du rapport de la commission régulière de réglementation créée en 1791. Mais, en 18 13, commence une période de disette qui fait fuir les serfs vers les Principautés roumaines, la Hongrie ou les régions moins frappées de la Transylvanie. Le 31 décembre 1813, François Ier effectue un voyage à travers toute la Transylvanie pendant lequel il prend conscience des sévices de la plus lourde année de disette. L’Empereur s’adresse, pour hâter la réglementation, au vieux gouverneur Bánffy. Celui-ci met sur pied une commission composée de fonctionnaires du Gubernium ainsi que des officiers des comitats, la commission qui s’inspire des travaux de celle de 1790-91, entend faire adopter la réglementation par la Diète. Mais c’est en fin de compte le conseil d’Etat qui tranche l’affaire, le 17 mai 1819, en refusant dans un premier temps de fixer l’étendue de la tenure servile car il juge nécessaire de procéder d’abord à un recensement. Ce projet se distingue par le fait – remarquable – qu’il définit enfin, au terme d’un demi-siècle, la corvée selon les normes de Hongrie: une journée hebdomadaire avec bête, ou deux à la main. Cela aurait été un grand allègement, bien que la situation du serf transylvain restât nettement pire que celle du hongrois, sa tenure étant bien plus petite que celles de Hongrie.
Mais, dans la Transylvanie elle-même, personne n’était favorable au projet. Pour la mise en exécution, le gouvernement central jugea plus opportun de dépêcher des personnes extérieures, c’est-à-dire des fonctionnaires de Hongrie, en tant que commissaires royaux avec, à leur tête, le vice-président de la Chambre hongroise, Antal Cziráky.
En outre, le projet provoqua le mécontentement de la noblesse terrienne. Dans les résolutions de protestation des assemblées de comitat, on retrouve les {f-439.} arguments, si détachés qu’ils soient de la réalité, du constitutionnalisme hongrois, et il y est même fait référence au Contrat social de Rousseau. Au combat participèrent entre autres quelques futures grandes figures du libéralisme transylvain, tels Miklós Wesselényi fils, qui débutait alors dans la carrière politique, ou Ádám Kendeffy et d’autres. Dans les affrontements autour de la réglementation servile, se confondent le conservatisme de la noblesse terrienne refusant toute concession aux serfs ainsi qu’une espèce de constitutionnalisme des Ordres qui exige que la question soit débattue à la Diète. Mais, après les actions communes de 1819-20, on suit deux chemins différents: celui des nobles conservateurs et celui des futurs libéraux qui iront jusqu’à proposer la solution définitive du problème des serfs: leur affranchissement.
Les serfs eux-mêmes manifestent un mécontentement tout autre. Des révoltes paysannes embrasent plusieurs régions, et notamment le comitat de Doboka, puis la partie orientale du comitat de Kolozs ainsi que les comitats de Küküllõ et de Fehér. A leur origine: des controverses autour de l’étendue de la tenure servile. En effet, les paysans exigent l’établissement de la taille de leurs terres et reprennent les anciennes doléances. Certains d’entre eux veulent rejoindre les gardes-frontières et, d’une manière générale, on formule la revendication de diminuer la corvée au niveau établi par la nouvelle réglementation.
Dans ces conditions, la tentative centrale de réglementer les services féodaux connut le même sort que les efforts antérieurs et s’essoufla avant même sa mise en application. Mais c’est justement dans ces années 1820 que l’élite de la noblesse terrienne, qui s’était quelque peu entichée, par l’intermédiaire de ses pères, des idées oppositionnelles de 1790-91, connut ses premières expériences politiques et parvint, en fréquentant les milieux marqués par Kazinczy et Gábor Döbrentei, à se mettre au pas des tendances libérales.
| 1. Le nouveau système de domination | TABLE DES MATIÈRES | II – L’Ere des réformes nationales (1830-1848) |